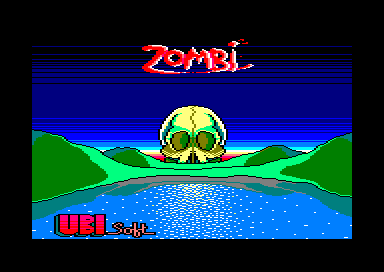(Interview publiée dans Joypad Spécial été 2007. L’interview s’étant déroulée par mail, je n’avais alors pas pu approfondir certains points qui l’auraient mérité. D’où le côté un peu « aseptisé » de cet entretien.)
Pouvez-vous nous parler des débuts? Comment Ubisoft s’est créé ? Il y a, pour beaucoup, cette image « magique », presque mythique, des cinq frères Guillemot qui créent la société dans une arrière-boutique… Y a-t-il un fond de vérité là-dedans ?
C’est en effet mon frère Michel (NDLR : parti créer Gameloft depuis) qui s’est rendu compte le premier qu’il y avait un vrai marché en France pour distribuer des jeux moins chers et avec moins de retards qu’en Angleterre. Michel a donc créé cette activité de vente dans le cadre de l’entreprise de nos parents en Bretagne, qui était spécialisée dans le négoce de produits agricoles. Après les premiers succès, il a appelé ses frères pour créer Ubi.
Pourquoi ce nom d’Ubisoft ?
« Ubi » vient du latin « ubiquitus » qui veut dire « présent partout ». Ce mot affichait notre volonté d’être présent à l’international.
On pense souvent que votre première production date de 1995 avec Rayman. Alors que dès 1986, vous avez édité et produit des titres comme Zombi, développés par des créateurs maison. Quels souvenirs avez-vous gardé de cette époque ?
Une époque sans doute beaucoup plus « artisanale » qu’aujourd’hui. Nous avons toujours voulu développer des jeux à côté de notre activité de distribution, mais c’était plutôt rock’n’roll car les créateurs étaient très jeunes, autodidactes et menaient également leurs études de front. Heureusement, nous avons eu de très beaux succès qui nous ont encouragés à continuer et c’est grâce à cette expérience que nous avons pu bâtir les studios parmi les plus créatifs de l’industrie.
Vous avez d’ailleurs édité de nombreux jeux d’aventure ou de rôle à l’époque : La Chose de Grotemburg, Fer et Flamme, RanX, B.A.T. I et II… Était-ce une volonté personnelle ou juste le besoin de suivre le marché, la fameuse « french touch », alors très courue ?
C’était surtout ce qu’aimaient développer les jeunes créateurs à l’époque. Les Français ont toujours été ultra créatifs. Nourri à la bande dessinée, au cinéma d’animation, le résultat était souvent surprenant. Nos écoles sont très bonnes, il est logique que les sociétés d’origine française soient performantes dans cette industrie.
D’ailleurs, je me souviens qu’Ubisoft avait loué une partie d’un château en Bretagne pour développer certains jeux, comme Iron Lord. Avez-vous quelques anecdotes à ce sujet ? Quel a été le résultat de cette « retraite » bretonne ?
Oui, nous avions en effet regroupé tous nos créateurs de jeux de l’époque dans ce château. Nous pensions que leur esprit créatif serait stimulé par le fait d’être réunis et aussi que nous pourrions sortir les jeux de l’époque dans les délais impartis ! Ces jeunes développeurs – certains n’avaient pas 18 ans – s’imaginaient même trouver des passages secrets et avaient commencé à démonter une grande cheminée médiévale. Le soir venu, ils avaient tellement peur qu’ils dormaient régulièrement dans la même chambre… Je me souviens également que nous avions recruté un très bon créateur américain au château, mais cela coûtait 1 000 euros rien que pour chauffer sa chambre de 80 m2. Il prenait aussi régulièrement le taxi pour aller acheter le papier toilette qui lui convenait… L’expérience fut au final moyennement efficace… mais nous avons mieux compris comment créer des jeux.
Dès 1991, vous ouvrez des filiales aux États-Unis, au Royaume-Uni… Quelle était alors la volonté directrice ? Investir le maximum de marchés, ou sortir soi-même ses propres jeux ?
Dans notre industrie, nous avions réalisé très tôt que pour bien vendre nos jeux, il fallait les vendre partout dans le monde. Il faut bien comprendre qu’aujourd’hui, créer un jeu new gen comme GRAW peut coûter 15 millions d’euros sans compter les dépenses de marketing. Comment vendre une superproduction comme Rayman ou Assassin’s Creed dans un seul pays ?
En 1995, Rayman sort. La première production interne pour Ubisoft. Le choc est immédiat et le personnage conquiert les joueurs. Avez-vous senti à ce moment que quelque chose se débloquait pour Ubisoft ?
Le développement de Rayman et son lancement ont constitué un double événement pour Ubi. D’abord, le développement, car nous avions engagé beaucoup plus de moyens que pour n’importe quel autre jeu auparavant. En termes de graphismes, de technologie – Rayman bougeait à 60 images par seconde -, nous avions repoussé bien loin les limites. Songez que nous avions engagé plus de 10 millions de francs à l’époque pour le créer ! Le lancement ensuite, dont le timing était parfait puisqu’il n’existait pas encore de jeux de plate-forme sur PlayStation. Rayman s’est donc directement placé dans les 5 premières ventes de la machine. Pour l’entreprise, ce succès a vraiment été le premier de nos studios internes naissants et un formidable encouragement pour le développement de notre modèle : posséder de puissants studios internes permet de mieux contrôler la qualité et les délais.
En 1996, Ubisoft entre en Bourse. Pour quelle raison ? Comment s’est effectuée cette entrée, alors que le jeu vidéo n’était pas encore entré dans les mœurs ?La Bourse nous a donné les moyens financiers pour développer très vite nos studios partout dans le monde. Sans elle, nous n’aurions pas réussi. Nous avons eu la chance d’être soutenus très tôt par les financiers et d’avoir une couverture dans la presse grand public et économique très importante qui nous a fait connaître auprès d’un public plus large.
Suit une période où Ubisoft exploite ses licences phare. Était-ce une façon de rassurer les actionnaires ? Ou est-ce la seule façon aujourd’hui de financer d’autres projets plus audacieux ?
Exploiter ses marques est une très bonne chose si les jeux sont exceptionnels. Voyez par exemple la véritable renaissance de Ghost Recon lors de son passage sur les consoles de nouvelle génération. Chez Ubi, nous sommes des passionnés de jeux avant tout, nous veillons donc aussi à créer le plus régulièrement possible de nouvelles marques comme nous sommes en train de le faire avec Assassin’s Creed ou Tom Clancy’s Endwar et il y en a beaucoup d’autres.
Qu’en est-il des 19% d’Ubi achetés par Electronic Arts ? Comment vivez-vous cette situation ?
Aujourd’hui, EA participe à hauteur de 15% dans le capital d’Ubisoft. Comme nous l’avons dit, nous privilégions l’indépendance car nous voulons continuer à créer des jeux d’excellence.
Quels sont les intérêts d’une délocalisation du travail (studios de Montréal, de Shanghai…) ? Pensez-vous continuer à créer des studios dans d’autres régions du monde ?
Il n’y a aucune délocalisation chez Ubisoft, bien au contraire. Nous recrutons beaucoup dans nos studios français depuis deux ans. Des succès comme Rayman contre les Lapins Crétins, Red Steel ou GRAW nous y encouragent. Mais un éditeur mondial doit s’implanter dans des pays où les coûts de production sont moindres. C’est pourquoi nous nous sommes installés très tôt au Québec ou en Chine, au Maroc ou en Roumanie. Il n’empêche que nos studios français de Paris, d’Annecy et de Montpellier sont parmi les plus performants et créatifs au monde.
Il semble qu’aujourd’hui, avec ses excellents résultats financiers, Ubisoft tente d’amener ses licences vers d’autres horizons (Splinter Cell : Conviction). Pour quelles raisons ? Des ventes en baisse ? Une demande du studio de développement ? Ou une évolution naturelle des licences ?
C’est surtout la volonté permanente de tirer nos créations vers le haut à tous les échelons chez Ubi. Dans le cas de Splinter Cell comme dans nos autres séries, nous essayons toujours de nous remettre en question, de faire évoluer les scénarios, les personnages… Nous visons l’excellence et pour cela nous donnons une grande autonomie à nos équipes de créatifs.
Actuellement, vous distribuez de nombreux RPG japonais en Europe, principalement des jeux Square Enix. Comment est venu le déclic ?
Cela faisait longtemps que nous souhaitions travailler en étroite collaboration avec la société Square Enix car nous comprenons fondamentalement leur niveau d’exigence. Des jeux d’une telle qualité devaient être soigneusement lancés en Europe et Ubisoft a aussi cette vocation de proposer ce qu’il y a de mieux pour les joueurs. On peut dire que les lancements des derniers volets de Final Fantasy ont été de véritables événements. En France, les productions japonaises sont adulées et la culture de la création de ces entreprises nous a fortement influencés quand nous avons créé nos premiers studios.
Quel est aujourd’hui votre meilleur souvenir de l’épopée de la société Ubisoft ?
Clairement, les succès de Rayman ou de Splinter Cell ont marqué un tournant dans l’histoire d’Ubi. Ils ont transformé notre société. Je me souviens également d’un contrat très important sur 7 jeux avec la société Epic aux États-Unis pour un montant de 450000 dollars à l’époque. Plus récemment, l’annonce de l’établissement de notre premier studio de cinéma numérique à Montréal a été un moment émouvant. Ces souvenirs sont nombreux…
Finalement, quel est l’avenir d’Ubisoft ?
Nous allons continuer à surprendre les joueurs par la qualité et la diversité de nos créations. Nos défis sont nombreux, mais ils sont bien engagés : les films, faire jouer les familles, travailler l’immersion et l’accessibilité de nos jeux… Nous avons cette chance formidable de disposer de consoles extraordinairement puissantes et originales qui démultiplient la qualité de notre expérience de jeu. Bien sûr, nous devons aussi poursuivre notre apprentissage des scénarios, des effets spéciaux, des animations en 3D. Créer reste plus que jamais le credo d’Ubisoft avec plus de 3200 talents dédiés à la production des jeux et je ne vois pas ce qui nous arrêterait.